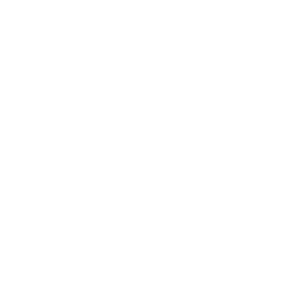Architecture des constructions agricoles (1789-1950)
À la fin du XVIIIe siècle, le bâtisseur François Cointeraux (1740-1830) proposait de créer une science nouvelle, l'agritecture, réunissant les savoirs de l'architecture et de l'agriculture. Il anticipait ainsi de deux siècles les recherches actuelles d'une architecture verte et d'une agriculture urbaine, dépassant l'opposition ville/campagne.Pourtant, de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale, la voie qui prévalut en France dans la théorie des constructions agricoles fut plutôt celle d'une modernisation des pratiques locales traditionnelles par des élites urbaines progressistes. Une abondante littérature s'attacha alors à réinventer les bâtiments de la ferme par l'emploi de matériaux, de techniques et de modèles nouveaux. Elle se préoccupait des habitations, des étables et des granges, mais aussi de programmes modestes : bergerie, toit à porcs, clapier, poulailler ou chenil. Ses maîtres mots étaient l'économie, le rendement, l'hygiène, la morale. Les solutions avancées, rationnelles, voire industrielles, n'étaient pourtant pas dénuées d'ambitions esthétiques.Des folies rustiques de l'aristocratie, dont le « Hameau de la Reine » de Marie-Antoinette est le modèle emblématique, aux fermes du Second Empire et aux établissements agricoles industriels du premier XXe siècle, se dessine une dialectique toujours actuelle de l'utile et du futile, du nécessaire et du superflu.C'est à une généalogie de cette hybridation entre architecture et agriculture, entre contingences fonctionnelles et ambitions culturelles, que cet ouvrage nous invite.Dans la même collection « Albums d'architecture » : Le Corbusier et l'immeuble-villas.