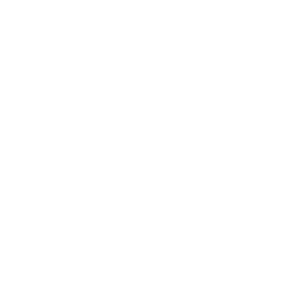Métamorphoses des mythes
RésumésMélanie ADA, Y a-t-il un mythe de Joseph??, RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?135-154.En partant de la conclusion de «?Qu'est-ce qu'un mythe littéraire???» où Philippe Sellier refuse à la figure génésiaque de Joseph le statut de mythe littéraire, l'auteur s'attache à l'inverse à démontrer que Joseph est pleinement un mythe littéraire, dans la mesure où il porte une vision métaphysique complexe et problématique, et où il a généré (du fait même du caractère problématique de la vision métaphysique qu'il exprime) quantité de reprises exégétiques et littéraires, du corpus biblique à nos jours.Marie-France DAVID-DE PALACIO, Errer et devenir : le parcours faustien de Job, de Goethe à Giran…, RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?155-170.Du prologue du Faust I de Goethe se dégage une promesse de salut, confirmée par les Anges au terme du Faust II : Faust sera sauvé parce qu'il a cherché, parce qu'il n'a cessé d'aspirer à autre chose qu'à une tranquillité passive. Cette forme de théodicée fondée sur l'inquiétude et le mou-vement se trouve déjà dans le pari entre Satan et Dieu dans le Livre de Job, qui servit de modèle à Goethe. L'action, accompagnée d'erreurs et d'errances, apparaît comme l'essence même de l'humain. À travers les interprétations du Livre de Job proposées par Kierkegaard, Pierre Leroux et Étienne Giran, relues en parallèle du Prologue au Ciel du Faust I de Goethe, l'étude des modalités de cette inquiétude à la fois peccamineuse et salvatrice se révèle féconde.Claude COLBUS PAUL, Le Faust d'Adolphe Dennery. Un drame fantastique entre Goethe et Klinger, RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?171-183.Si le Faust de Klinger était relativement connu au début du XIXe siècle, le public français n'associa jamais le nom de Faust qu'au drame éponyme de Goethe. Et tous les spectacles français baptisés du nom du nécromancien germanique se fondent exclusivement sur la tragédie goethéenne. Seul Adolphe Dennery écrivit un drame qui s'inspire autant du Faust de Goethe que de celui de Klinger. Mais sa pièce ne se résume pas à une synthèse des deux chefs-d'œuvre. Plus qu'une simple réécriture, son spectacle offre une nouvelle version du mythe faustien, dans laquelle une femme idéalisée montre à son amant le chemin de sa rédemption, conformément à l'essor du culte marial caractéristique de cette époque.Aurélia GOURNAY, Don Juan et ses doubles au XXe siècle : questionnements identitaires et déconstruction du mythe, RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?185-198.Les réécritures contemporaines renouvellent les relations, déjà très étroites, entre le mythe de Don Juan et le motif du double. En se confrontant à ses doubles, c'est, non seulement, son iden-tité que le héros questionne, mais aussi son rapport aux femmes et à l'amour. Mais ces dédou-blements permanents peuvent aussi fragiliser le scénario mythique.Dimitrios KARAKOSTAS, Le Paysage infernal?: cadre de l'action ou élément consubstantiel du récit fantastique et du roman de guerre?? (Nameless City de H.P. Lovecraft et La route des Flandres de Claude Simon), RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?199-207.Le paysage infernal, celui du pays des morts tel que l'imaginaient les Grecs anciens et les Ro-mains est un élément très important de la littérature fantastique et du roman de guerre. Le thème de la mort constitue le pivot du récit dans ces deux contextes littéraires, si différents. La lecture des extraits des textes étudiés nous révèle l'importance de l'utilisation de l'antithèse et de la négation d'un point de vue stylistique. L'univers chthonien et nocturne, évoqués par H.P. Lovecraft et Claude Simon, les auteurs étudiés, symbolisent aussi les profondeurs psychiques. La notion d'intemporalité nous rapproche du rêve ou de la condition chaotique. L'écriture à la première personne dans les œuvres choisies exprime, par ailleurs, la présence constante de le conscience humaine s'opposant à la monstruosité ou à l'absurdité environnante.Delphine GACHET, L'enfer d'Eurydice : de quelques subversions du mythe d'Orphée et d'Eurydice dans la littérature italienne contemporaine (XXe-XXIe?siècles), RLC?LXXXVIII, n°?2, avril-juin 2014, p.?209-222.De Pavese jusqu'à Magris, en passant par Buzzati, Bufalino et Calvino, de grands noms du roman italien contemporain ont revisité le mythe de la descente aux enfers d'Orphée. Ces réécritures, qui se sont échelonnées dans le temps et diffèrent par les postures d'écriture adoptées, ont comme point commun la subversion de quelques données d'un mythe qui présente Orphée en poète sublime, et Eurydice en simple muse inspiratrice. C'est autour du mythème fondamental qu'est le «?regard assassin?», que se joue la subversion?: ces interprétations modernes, sans altérer la structure matricielle du mythe, sont ouvertes à de nouveaux questionnements. Les romanciers de notre modernité, au moyen des transformations, subversions que permet la plasticité de ce mythe, peuvent lui faire dire quelque chose sur notre présent.Anne TEULADE,...